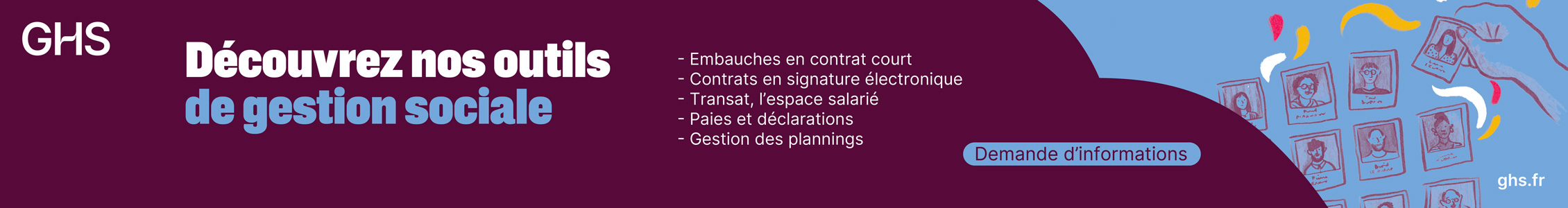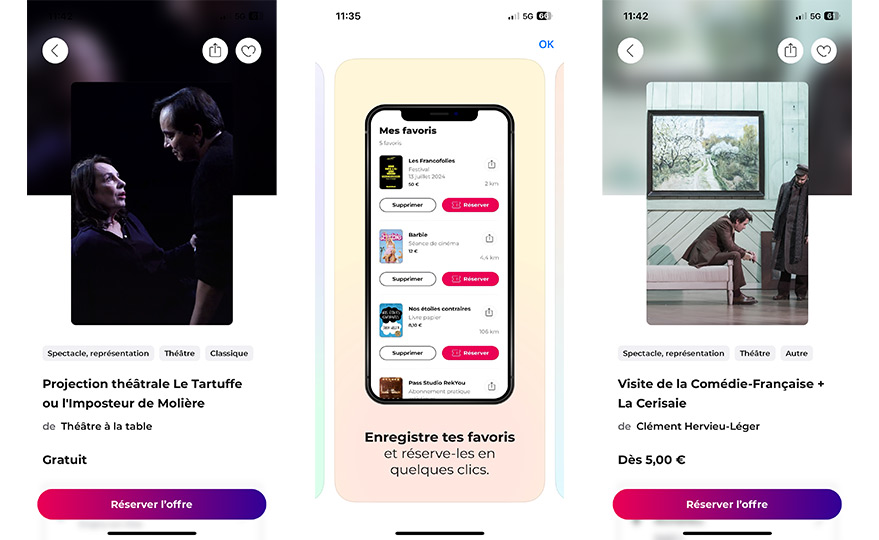
Dans son rapport de mi-décembre sur le Pass culture, la Cour des comptes se concentre, elle aussi, sur sa part individuelle et la manière dont les 4,2 millions (total depuis 2019) de « jeunes utilisateurs se sont saisis de ce nouvel outil […] eu égard aux objectifs larges et ambitieux ». C’est un « premier bilan » des magistrats qui n’avaient jusqu’ici évalué sévèrement que sa mise en place administrative. Comme l’IGAC, la Cour estime que le dispositif fonctionne (84 % des jeunes de 18 ans révolus étaient inscrits en septembre 2024), avec même un « réel succès en termes de couverture globale », mais peine à atteindre ses cibles (« parmi les jeunes issus des classes populaires, seuls 68 % ont activé leur pass »), jugées floues, le tout pour un coût important que la Cour demande de revoir (lire ci-dessous). Cet avis est le dernier outil dont avait besoin la ministre de la Culture pour réformer ce Pass dont le magot commence à jurer.
Les inflexions de Rachida Dati
Prudente, elle a esquissé des inflexions cette année. « La ministre partage [ces] préoccupations, par ailleurs identifiées dans plusieurs études et évaluations. Le ministère a déjà initié plusieurs actions pour y répondre », a-t-elle affirmé aux magistrats. Pour elle, la part individuelle « n’est pas devenue l’outil de démocratisation culturelle qu’avaient à l’esprit ses initiateurs », et il faut un « chemin d’équilibre » entre la volonté présidentielle et le risque qu’elle « ne fasse que conforter la reproduction des habitudes de consommation », disait-elle en mai. Une « intensification des pratiques culturelles déjà bien établies chez les jeunes », assure de son côté la Cour, qui « contribue à confirmer le risque d’effet d’aubaine ». À la SAS Pass Culture, la ministre demandait en octobre de travailler sur la justice sociale avec une modulation du crédit alloué en fonction des ressources familiales, sur l’incitation à la diversité des pratiques, l’éditorialisation de l’application et la médiation avec les jeunes, et l’ouverture des données d’utilisation afin de que le ministère puisse, exigence de la Cour aujourd’hui, « évaluer l’évolution des pratiques des jeunes avant et après l’utilisation du Pass culture ».
Enfin, en novembre, Rachida Dati lançait une « mission flash » avec pour objectif de soigner le spectacle vivant, parent ultra-pauvre des achats des bénéficiaires, sans déshabiller les libraires. Désormais, il semble qu’une réduction des montants alloués en part individuelle soit dans les cartons. Sans grande nouveauté, ce rapport servira de marteau sur un clou déjà bien enfoncé.
Jérôme Vallette
Une « réduction du montant alloué aux jeunes » ?
Comment rendre « soutenable » le dispositif dans « un contexte budgétaire contraint », s’interroge le ministère qui ne veut pas fragiliser « l’action en direction des publics les plus éloignés ou vulnérables ». La Cour des comptes propose que les « offreurs », qui ne participent qu’à 6 % au dispositif, contribuent davantage, mais aussi que le « montant du crédit alloué aux jeunes âgés de 18 ans soit réduit », par exemple en passant de 300 euros à 200 euros, avec à la clé une économie qui « pourrait atteindre 30 millions à 40 millions d’euros sur la durée d’utilisation du pass (24 mois sur la cohorte 2025) ». Bref, « la Cour considère qu’un recalibrage du dispositif est […] souhaitable eu égard aux résultats contrastés de cette politique ».
En partenariat avec La Lettre du Spectacle n°573
Crédit photo : D. R.